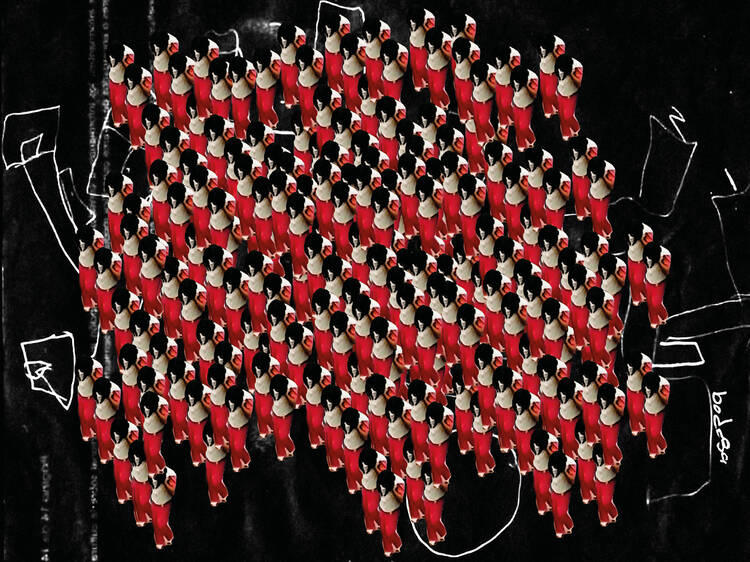Plus d'expos
Alerte rouge, sortez les gosses : « Certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité… » Plutôt deux fois qu’une, même. À la Bourse, comme de coutume au royaume d’Araki, il y a de la nudité, des corps féminins languides et du kinbaku. Beaucoup de kinbaku, cet art ancestral du bondage japonais visant à entraver une personne à l’aide de cordes. Mais – surprise ! – parmi ce festival de peaux laiteuses empêtrées dans des positions inconfortables (aïe pour elles), il y a aussi le portrait d’un inconnu attablé dans un restaurant, quelques natures mortes et plusieurs paysages urbains. Et pour cause : la centaine de pièces exposées, qui constitue la série Shi Nikki (Private Diary) adressée à Robert Frank (oui, oui, l’auteur du célébrissime Les Américains), ne s’articule pas exclusivement autour de l’érotisme, thème prédominant de l’artiste japonais.
Percée dans le New York des années 1950 à Saint-Germain-des-Prés.
Discover Time Out original video